« Révolution culturelle » par Jean-Pierre Digard (suite et fin)
Dans notre précédente édition (numéro 114 du 19 décembre 2008) nous avons publié la première partie de l’intervention que Jean-Pierre Digard, sociologue, directeur de recherche émérite au CNRS a faite lors d’une des tables rondes de l’assemblée
Photo 1 sur 1
générale de la FNC. Après avoir brossé le tableau de l’évolution du cheval dans la tourmente des mutations sociales et culturelles du XXIe siècle, le sociologue se pose la question de la place particulière qu’occupe le cheval dans ce contexte.
II. Dans ce paysage général, quelle est la place particulière du cheval ?
Entre les groupes des animaux de rente et celui des animaux de compagnie, le cheval occupe aujourd’hui une position d’animal intermédiaire. Depuis qu’il a quitté la sphère de l’utilitaire pour entrer dans celle des loisirs, le cheval a changé de milieu sociologique et culturel.
1. Les nouveaux milieux sociaux du cheval
1 - L’élevage équin. Autrefois élevé par des exploitants agricoles, le plus souvent en complément d’autres activités (élevage laitier ou allaitant, polyculture, etc.), le cheval est, depuis une dizaine d’années, élevé par un nombre croissant (aujourd’hui les 2/3) de personnes issues, non de l’agriculture, mais d’activités liées à l’utilisation du cheval (équitation sportive ou de loisir, attelage), et qui sont, du fait de cette origine, porteurs d’une culture équestre nouvelle (voir plus loin).
2 - L’utilisation des chevaux lourds. Autrefois instrument de travail des agriculteurs, des ouvriers et des entreprises de transport, les chevaux lourds sont devenus en majorité des animaux de boucherie. Rappelons qu’instaurée dans la deuxième moitié du XIXe siècle à la fois comme moyen d’amélioration de l’alimentation humaine (I. Geoffroy Saint-Hilaire) et comme instrument de protection du cheval contre les mauvais traitements (É. Decroix et SPA), l’hippophagie a été organisée en filière dans les années 1970 par les Haras nationaux, alors dirigés par Henry Blanc, pour sauvegarder les neuf races de trait françaises. Même si des reprises d’utilisations traditionnelles des chevaux de trait voient aujourd’hui le jour, elles restent marginales.
3 - L’utilisation des chevaux de selle. Autrefois aristocrates et/ou militaires, hommes en tout cas, les « nouveaux cavaliers » sont en fait des cavalières (à 80 %), des jeunes et des membres des classes moyennes. Cette mutation est liée à la « massification » (et non à la « démocratisation ») de l’équitation, elle-même consécutive à l’essor du poney et du tourisme équestre dans les années 1960 et 1970. Cette évolution sociologique a entraîné une évolution culturelle : de la culture équestre de ?l’« homme de cheval » issue du XIXe siècle, fondée sur l’utilisation respectueuse du cheval (« qui veut aller loin ménage sa monture »), on est passé à une nouvelle culture équestre baroque fondée sur la diversification des pratiques équestres, souvent empruntées à des équitations ?« exotiques » : américaine, espagnole (doma vaquera), argentine (pato > horse-ball), etc, hédoniste délaissant l’effort technique et sportif au profit du plaisir et de la convivialité et sentimentale on ne respecte plus le cheval, on l’aime... Le cheval est devenu le troisième animal préféré des Français après le chat et le chien, tendance encouragée par toute une littérature à l’eau de rose, de mauvais petits romans d’amour de petites filles pour leurs poneys, qui inondent les librairies spécialisées... À l’occasion de la préparation de la loi française du ?6 janvier 1999 relative à la protection des animaux, la revue Cheval Magazine ?(n° 299 « spécial 25 ans », 1996, p. 55-57) a d’ailleurs explicitement réclamé que le cheval soit, au même titre que le chat et le chien, légalement reconnu comme ?« animal de compagnie ». La même revue et d’autres organes de presse ont fait ou font encore régulièrement campagne contre l’hippophagie, contre la caudectomie, contre le marquage au fer, contre le barrage des chevaux d’obstacle, contre le danger (pour les chevaux) des obstacles fixes (on se souvient que des associations américaines avaient tenté de faire annuler le complet aux JO d’Atlanta en 1996), contre certaines épreuves d’endurance, contre la « claustration » en box qui serait source de troubles comportementaux, contre la monte en mains assimilée à un « viol de la jument » j’en passe et des meilleures !
À cet égard, un fossé se creuse chaque jour davantage entre les professionnels du cheval, qui attendent de leurs animaux des performances et des revenus, et la masse des usagers du cheval dont la pratique ordinaire tend plutôt vers la sous-utilisation voire la non-utilisation de l’animal.
2. Plusieurs pratiques symptomatiques d’un nouveau type de rapport au cheval gagnent du terrain
1 - Le « cheval-potager ». Il s’agit d’un cheval que l’on garde chez soi, dans un coin de garage ou de jardin (d’où son nom). De ce fait, l’animal acquiert un statut familial : il est le centre des loisirs de toute la famille. Son alimentation (souvent trop riche) et son entretien (inadapté) deviennent l’affaire de tous et absorbent l’essentiel de leur temps libre. Dans la plupart des cas, le « cheval-potager » reste et c’est même là une de ses caractéristiques principales peu utilisé, ou voué à des activités comme la randonnée, qui privilégient l’intimité avec l’animal beaucoup plus que la technique équestre ou la performance sportive. Ce type d’hébergement et de pratique du cheval domine évidemment dans le Midi, qui bénéficie de conditions climatiques favorables (les élevages de loisir de la périphérie des villes sont en majorité des élevages équins).
2 - Le « horse-toy ». On connaît l’existence des falabellas et autres “horse-toys” de 45 cm au garrot. Importés d’outre-Atlantique, ils restent peu nombreux en France mais connaissent un succès grandissant, comme en témoigne leur prix qui a été multiplié par quatre ou cinq en moins de dix ans. Ceux présentés en 2003 au Salon de l’agriculture de Paris étaient vendus entre 1 800 et 3 000 € (12 000 et 20 000 francs) pièce et explicitement affichés comme « chevaux de compagnie », au grand dam des éleveurs de traits lourds des stands voisins qui militaient, eux, pour que le cheval conserve son statut de produit agricole. Déjà, pour les « chevaux d’appartement », une société australienne a mis sur le marché en 1999 les « couches pour chevaux ». Et l’on a déjà pu voir, au bois de Vincennes, des falabellas être promenés, non point en licol et longe, mais en collier et laisse !
Le paradoxe de cette situation est que le risque majeur de maltraitance des chevaux se situe aujourd’hui chez ceux qui prétendent les « aimer » le plus, et qui, croyant « bien faire » ou, en tout cas, ne pas mal faire, prennent chez eux de ces « chevaux potagers » ou « d’appartement » ou encore des chevaux « à la retraite ». Désormais coupés de la culture traditionnelle de l’« homme de cheval », ces « nouveaux propriétaires » n’ont souvent pas la moindre idée de la manière de nourrir et de soigner leurs protégés. Malgré eux, ils se rendent coupables de maltraitance par ignorance. Car, à cet égard, il en va des chevaux comme des autres animaux : plus ou les « aime », moins on les connaît; et moins on les connaît, moins bien on les traite.
3 - L’équitation auto-proclamée « éthologique ». Outre quelques avancées réelles (notamment en matière de débourrage), son succès s’explique par une habile association de plusieurs ingrédients au goût du jour. En premier lieu, l’étiquette d’« éthologie », totalement abusive : ou bien toutes les équitations sont nécessairement « éthologiques » (au sens commun), ou bien celle-là ne l’est pas plus que les autres ! De cette première illusion, on glisse tout naturellement, en second lieu, vers la supercherie qui consiste à faire croire au chaland, par une subtile mise en scène de la non-violence, que les méthodes des « chuchoteurs » et autres « nouveaux maîtres » méthodes prétendues « naturelles » ou inspirées d’un pseudo-idéal amérindien d’harmonie entre l’homme et ses « frères animaux » seraient fondées sur l’absence de domination du cheval ou sur sa persuasion afin de l’amener à consentir à sa propre domination. Le tout se traduit, en troisième lieu, par une flagrante sous-utilisation du cheval, la plupart des « prouesses » des « chuchoteurs » consistant en manipulations de l’animal à pied manipulations qui s’apparentent davantage aux concours d’« agility » canins qu’aux sports équestres, contribuant ainsi au processus sournois de canisation dont le cheval est actuellement l’objet.
Loin d’être anodines, ces attitudes et ces pratiques nouvelles font peser sur l’avenir des activités équestres et même de l’espèce chevaline un risque redoutable. En effet, le surinvestissement affectif et le protectionnisme dont le cheval est actuellement l’objet vont de pair avec une idéologie de non-utilisation de l’animal. Déjà, dans les faits, le cheval de selle n’est plus perçu que secondairement en tant que monture; des enquêtes menées dans des centres équestres et divers sondages indiquent qu’un nombre significatif de cavaliers de base se montrent, au fond, plus intéressés par la fréquentation des chevaux que par la pratique de l’équitation elle-même; on observe par ailleurs qu’un nombre croissant d’amateurs femmes pour la plupart, ce qui n’est sans doute pas un hasard acquièrent des chevaux à seule fin de... ne pas les utiliser. Loin d’être exceptionnelle, cette évolution correspond à l’un des aspects constitutifs du phénomène « animaux de compagnie » : pour accéder pleinement à leur statut d’intimes de l’homme, ces animaux doivent être entièrement disponibles pour leur maître, ne servir à rien d’autre qu’à sa compagnie. En Europe, le chien à partir de la Renaissance, le chat à partir du XVIIIe siècle, ont suivi cette trajectoire. Depuis les années 1950, le cheval s’est engagé à son tour dans une semblable évolution : jamais il n’a été aussi bien traité ni autant aimé que depuis qu’il ne « sert » plus à la guerre, aux champs ou sur les routes.
Bref, le statut actuel du cheval tend vers celui de l’animal de compagnie. ?Y parviendra-t-il un jour ? Il y a tout lieu d’en douter, ne serait-ce qu’à cause de sa taille (exception faite du falabella) et de son incapacité à contrôler ses sphincters. Or l’histoire nous apprend que tout animal qui, ayant quitté le groupe des animaux de rente, ne réussit pas à se faire admettre dans celui des animaux de compagnie, est condamné à ne plus constituer qu’une nuisance comme les mustangs aux États-Unis ou les brumbies en Australie. Autrement dit, si les sensibilités animalitaires contemporaines s’inscrivent dans la longue durée, l’espèce chevaline qui, il faut s’en souvenir, ne subsiste plus aujourd’hui qu’à l’état domestique risque fort de se trouver menacée dans un avenir plus ou moins lointain. À ceux qui jugeraient cette perspective exagérément alarmiste, on se contentera de rappeler que les races de chevaux lourds sont d’ores et déjà menacées d’extinction par la lame de fond anti-hippophagique, en l’absence de débouchés de substitution suffisamment consistants.
Comme la langue d’Ésope, l’« amour » du cheval contient à la fois le meilleur et le pire. Sans aucun doute, c’est lui qui a servi de moteur au spectaculaire essor des sports et des loisirs équestres depuis une trentaine d’années, ainsi, par voie de conséquence, qu’au maintien de l’élevage équin. Mais, sous la poussée du mouvement animalitaire et de l’idéologie de non-utilisation de l’animal que celui-ci véhicule, cet engouement peut aussi, si l’on n’y prend pas garde, conduire à l’évolution inverse. Alors que la plupart des disciplines sportives ont progressé du jeu au sport, l’équitation paraît déjà, à bien des égards, en train d’effectuer le trajet en sens contraire : des sports équestres vers des activités, à dominante ludique et sentimentale, de simple manipulation des chevaux. Source d’embellie numérique, la popularité et la massification du cheval peuvent conduire à sa banalisation et à une dégradation qualitative de ses usages, à une décadence, à une récession et enfin à une quasi-disparition des activités équestres.
III. Que faire ?
En résumé, quatre catégories de personnes ayant chacune leurs pratiques et leurs discours propres se trouvent aujourd’hui en présence :
1 - des professionnels du cheval, héritiers et dépositaires d’une culture équestre ancienne, agricole ou sportive, mais qui sont devenus minoritaires;
2 - une majorité de citadins, possesseurs ou non d’animaux de compagnie, mais qui ont tendance à voir tous les animaux, y compris les chevaux, sous les traits de leurs animaux familiers;
3 - une minorité infime mais très active de militants animalitaires qui propagent, auprès d’un public mal informé, une vision péjorative de l’élevage et de l’utilisation des animaux;
4 - une population croissante de « nouveaux cavaliers » et de « nouveaux éleveurs », pour la plupart issus de la catégorie (2), qui sont le vecteur inconscient ou involontaire de l’introduction dans la catégorie (1) de sensibilités et d’attitudes de la catégorie (3).
Les actions à mener doivent donc viser à :
1. soutenir les éleveurs professionnels;
2. informer le grand public;
3. combattre les animalitaires;
4. former les néo-éleveurs.
Dans la pratique, les quatre niveaux se confondent ou se recoupent plus ou moins. Reprenons-les un par un en commençant par celui dont l’urgence apparaît la plus grande.
1. Combattre l’activisme animalitaire
L’activisme animalitaire s’est pour l’instant peu attaqué directement à la filière Cheval. Les secteurs visés ont surtout été le transport des chevaux déjà réglementé outre-mesure, de sorte que l’on voit mal ce qui pourrait être encore être ajouté, sauf à l’interdire complètement ! et la boucherie chevaline voir les campagnes calomnieuses de la Fondation Brigitte Bardot (jusque dans un supplément « Équitation, nouvelle passion française » au journal Le Monde du 8 mai 20087, p. VII, sous le titre « Le cheval, vous l’aimez comment : en ami ou en rôti ? »).
Pour le reste, on peut sans doute trouver, ici ou là, des équidés en situation de maltraitance. Mais il s’agit presque toujours de cas isolés, de sorte que, dans l’ensemble je ne crains pas de le dire, dans la France de ce début du XXIe siècle, les équidés maltraités ou à l’abandon sont proportionnellement moins nombreux que les humains en grande détresse économique et psychologique, les chevaux martyrs plus rares que les femmes et les enfants battus ou abusés, et les conditions de transport des chevaux meilleures que celles des Parisiens sur la ligne 13 du métro aux heures de pointe.
Le problème principal, dans ce domaine, réside moins dans le mal-être animal lui-même que dans les dimensions irrationnelles et affectives qui donnent à cette notion une résonance particulière dès lors qu’elle s’applique au cheval, espèce à forte valeur affective et symbolique. Ainsi, par exemple, on peut rappeler que la généralisation du logement des chevaux en box, que certains assimilent aujourd’hui à de la ?« claustration », a été dictée par des considérations anthropomorphistes tout autant que de commodité. En réalité, la plupart des chevaux se montrent plus calmes à l’attache tête au mur en stalles qu’en liberté dans 9 m2. Ce ne sont donc pas les chevaux que l’attache dérange, mais les hommes !
D’autres dangers potentiels existent, dont la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie (adoptée le 13 novembre 1987, ratifiée par la France le 8 juillet 2003 et dont le décret d’application date du 28 août 2008) offre un bon exemple. Son article 1 donne la définition suivante : « On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme, notamment dans son foyer, pour son agrément et en tant que compagnon » (définition qui a été introduite sous une forme resserrée dans le Code rural, art. L214-6, J.O. du 21 septembre 2000 : « On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme pour son agrément »). Traitant du dressage, l’article 7 stipule que « Aucun animal de compagnie ne doit être dressé d’une façon qui porte préjudice à sa santé et à son bien-être, notamment en le forçant à dépasser ses capacités ou sa force naturelles ou en utilisant des moyens artificiels qui provoquent des blessures ou d’inutiles douleurs, souffrances ou angoisses ». Outre qu’elles portent atteinte au caractère positif du droit français – quel juge sera en mesure de statuer sur des notions aussi discutables que les « force naturelle » d’un animal ou le caractère « artificiel » de moyens de dressage ?, ces définitions et ces dispositions peuvent fort bien concerner le cheval et s’appliquer au mors, aux enrênements, aux éperons. Qui peut dire, au train où vont les choses, qu’ils ne seront pas un jour interdits, comme serait interdite toute utilisation du cheval autre que celle d’animal de compagnie, idéal bardotien du dada-à-sa-mémère.
La riposte doit être à la hauteur de la réalité de la menace animalitaire. Commençons par quelques exemples de ce qu’il ne faut surtout pas faire :
1 - Ne rien faire, pratiquer la politique de l’autruche, rentrer la tête dans les épaules et se boucher les oreilles en espérant que le boulet passera à côté et ira tomber sur le voisin : on ne méditera jamais assez la terrible leçon de l’interdiction de la chasse à courre en Grande-Bretagne !
2 - En faire trop, devancer les critiques dans l’espoir de calmer le jeu. C’est ce qu’ont cru pouvoir faire, en limitant le nombre de coups de cravache à trois successifs, la FFE dans le Règlement général des compétitions en 1990 et France Galop dans le Code des courses au galop en 2005. La mise au pilori de ce geste technique élémentaire qu’est le coup de cravache n’a fait en réalité que donner des gages aux animalitaires et que créer un précédent dont ils ne manqueront pas de tirer argument pour en réclamer plus encore.
3 - Jouer au malin en s’engouffrant dans ce que l’on croit représenter un nouveau marché. C’est ainsi que la FFE, alléchée par la mode des chuchoteurs, s’empressa de créer des diplômes d’équitation éthologique.De même, face à la féminisation, elle en fait toujours plus pour les filles, et quand enfin elle se demande « Qu’offrir d’attractif aux garçons ? » (REF de janvier 2007), ce sont tous les clichés sexistes les plus éculés qu’elle étale : frilosité des filles, combativité des garçons, etc. Les Haras nationaux ne se montrent guère plus brillants quand, croyant tirer les enseignements d’un sondage de 2006 commandité par eux et la FIVAL (Fédération interprofessionnelle du cheval de sport et de loisir) qui montrait que les Français s’intéressent plus au spectacle et à la fréquentation des chevaux qu’à l’équitation proprement dite (ce que les sociologues savaient déjà depuis longtemps !), les Haras ont développé une campagne de « communication » sur le thème : « si l’on veut exploiter ce marché, il faut s’inscrire dans la stratégie de consommation porteuse du moment ». C’est-à-dire ? Produire du cheval de compagnie ?
4 - Camper sur des positions uniquement défensives en tentant de répondre point par point aux accusations des animalitaires, et se laisser ainsi entraîner sur leur terrain. Telle fut, faute de préparation, l’expérience amère des « Rencontres Animal et Société » du printemps dernier au ministère de l’Agriculture où je siègeais en tant que scientifique, avec Jean-Luc Poulain qui représentait la FNSEA.
Au total, il n’existe aucune raison objective de se montrer complaisants envers les thèses animalitaires, qui n’ont déjà que trop gagné de terrain, compte tenu de leur caractère très minoritaire. Il y a au contraire toutes les raisons de les ignorer ou de s’y opposer, en vertu d’un principe de réalité simple qui est celui-ci : ce qui ne va pas dans le sens de l’intérêt de l’homme n’a aucune chance d’être adopté et de s’inscrire dans la durée. La seule manière réaliste d’envisager la question de nos rapports aux animaux consiste donc à se poser les questions suivantes : qu’est-ce que les hommes (en y incluant nos descendants pour une perspective durable) ont intérêt à faire ou à ne pas faire aux animaux ? Si les animaux peuvent trouver avantage à un meilleur traitement, quel intérêt la bien-traitance animale représente-t-elle pour l’homme ? Sur le plan matériel, permet-elle une optimisation de l’utilisation des animaux, ou bien contribue-t-elle au contraire à la limiter ? Dans cette dernière hypothèse, jusqu’où l’homme est-il prêt à restreindre ses attentes au profit de la bien-traitance des animaux ?
À moins d’une improbable révolution dans les techniques d’élevage, on imagine mal des systèmes futurs qui réussiraient à n’imposer aucune contrainte aux animaux; c’est donc dans les domaines (comme le transport des animaux vivants) où l’intérêt des exploitants rejoint celui des animaux que les améliorations les plus sensibles ont été et peuvent encore être obtenues.
2. Il est plus motivant et donc plus efficace de se battre pour quelque chose que contre quelque chose
Il faut donc privilégier les actions constructives :
1 - soutenir les éleveurs agriculteurs et néo-ruraux, notamment en leur proposant des compléments de formation technique (gestion des prairies, alimentation...) et économique (gestion, débouchés, commercialisation...)
2 - informer le public par des campagnes d’explication et de sensibilisation sur les métiers et les produits de l’élevage
Loin de moi la prétention de vous dire ce dont vous avez besoin dans ces domaines. Permettez-moi simplement d’insister, pour terminer, sur quelques grandes orientations générales :
1 - La situation des éleveurs est déjà difficile, leur métier particulièrement contraignant, leur niveau de vie en baisse. Il est ignoble, en plus, de les culpabiliser en faisant peser sur eux le soupçon de maltraiter leurs animaux.
Sans parler des couvertures insultantes de publications mettant en parallèle élevages industriels et camps d’extermination nazis (cf. Florence Burgat, Les animaux d’élevage ont-ils droit au bien-être ?, INRA, 2001), je garde un souvenir particulièrement pénible de l’interview, sur un ring de présentation au Salon de l’agriculture 2008 à Paris, d’un éleveur de splendides chevaux lourds : cet homme était visiblement paralysé par la peur de devoir expliquer qu’il élevait des chevaux pour la boucherie !
Face aux campagnes ignobles et insultantes contre la filière Viande, il faut soutenir les professionnels et les aider à effectuer au mieux leur métier : le stress des animaux dans certaines conditions d’élevage est peu de chose à côté du stress des éleveurs croulant sous des contraintes en tous genres de plus en plus lourdes. Et comme le reconnaît lui-même un des plus ardents avocats de la recherche sur le « bien-être animal » : « une insistance trop exclusive sur le bien-être animal risque de compromettre le bien-être de l’éleveur » (Robert Dantzer).
2 - La dénonciation des mensonges et des excès des uns, les animalitaires, ne doit pas faire oublier les carences de quelques autres. Aucun éleveur n’a intérêt à maltraiter des animaux ni à leur imposer des conditions d’élevage ou de sélection (hypertypes) contraires à leur bien-traitance à long terme et à la survie même de certains élevages à moyen terme : cela comporte des risques pour la santé animale comme pour la santé humaine, y compris psychique, c’est un signe d’incompétence et de manque de professionnalisme, et c’est économiquement improductif.
3 - Dans le domaine de l’action à court et à moyen terme, il faut privilégier les mesures incitatives et l’information plutôt que les règlements, lois et mesures répressives que réclament les associations animalitaires (souvent pour des motifs qui sont loin d’être désintéressés) règlements, lois et interdictions dont l’empilement conduit à une jungle juridique de plus en plus impénétrable.
Cette information doit cibler principalement le grand public pour lui faire comprendre que le statut d’animal de compagnie le seul qu’il connaisse, dans lequel certains voudraient entraîner le cheval, est un statut très particulier, qui ne saurait être étendu à tous les animaux, et un statut qui n’est pas toujours aussi enviable qu’il le croit : traiter un animal pour ce qu’il n’est pas (en l’anthropomorphisant ou en voyant en lui un substitut d’enfant) est une forme de maltraitance et un facteur de troubles du comportement de plus en plus fréquents d’où l’éclosion, relativement récente, de la spécialité de « vétérinaire comportementaliste ».
4 - On a vu que les instances dirigeantes de certains organismes scientifiques ou de certaines filières animales se laissent bluffer par les discours animalitaires au point de fonder sur eux des programmes de recherche ou des stratégies marketing.
Osons une comparaison : imaginons que, constatant le gouffre qui sépare la culture des professeurs de lettres et celle des élèves des ZEP, le ministère de l’Éducation nationale décide d’enseigner désormais le « neuf-trois » au lieu du français dans les lycées et les collèges, et de remplacer Molière et Hugo par Doc Gynéco et NTM dans les programmes du secondaire. Ce serait évidemment absurde. C’est pourtant ni plus ni moins ce que les Haras nationaux suggèrent de faire : puisque le modèle animal dominant dans la société occidentale est celui de l’animal de compagnie, il faudrait transformer les animaux de rente en animaux dont la production et l’utilisation (si tant est qu’il soit encore possible ?d’« utiliser » de tels animaux) ne serait plus régie que par les exigences de leur ?« bien-être » ou, plus exactement, de la représentation que les hommes s’en font.
Il faut absolument rompre avec ce suivisme démagogique : toujours tout aligner sur les attentes du plus grand nombre, surtout dans des domaines techniques très spécialisés comme les productions animales, revient à tirer tout et tout le monde vers le bas.
Conclusion
Les organismes publics (Haras et autres) et les organisations professionnelles représentatives ont une responsabilité particulière. Ils doivent laisser la « communication » à d’autres et remplir sans concessions une mission d’information des professionnels et du public. « Communiquer » (au sens actuel), c’est dire au public ce qu’il a envie d’entendre, pour le séduire à des fins diverses (électorales, clientélistes ou d’audience). L’informer, c’est lui dire la vérité. Et la vérité, pour ce qui concerne notre propos, c’est :
1 - que les chevaux, aujourd’hui en Europe occidentale, manquent moins de « bien-être » que de débouchés économiquement rentables et durables;
2 - que les débouchés, pour les chevaux, ce sont des utilisations;
3 - qu’il ne saurait y avoir d’utilisations des animaux sans fortes contraintes pour ceux-ci, ainsi, d’ailleurs, que pour les hommes qui les produisent et les utilisent mais ce n’est pas à vous que je vais l’apprendre.
Tout le reste n’est que littérature à l’eau de rose.
Jean-Pierre Digard
II. Dans ce paysage général, quelle est la place particulière du cheval ?
Entre les groupes des animaux de rente et celui des animaux de compagnie, le cheval occupe aujourd’hui une position d’animal intermédiaire. Depuis qu’il a quitté la sphère de l’utilitaire pour entrer dans celle des loisirs, le cheval a changé de milieu sociologique et culturel.
1. Les nouveaux milieux sociaux du cheval
1 - L’élevage équin. Autrefois élevé par des exploitants agricoles, le plus souvent en complément d’autres activités (élevage laitier ou allaitant, polyculture, etc.), le cheval est, depuis une dizaine d’années, élevé par un nombre croissant (aujourd’hui les 2/3) de personnes issues, non de l’agriculture, mais d’activités liées à l’utilisation du cheval (équitation sportive ou de loisir, attelage), et qui sont, du fait de cette origine, porteurs d’une culture équestre nouvelle (voir plus loin).
2 - L’utilisation des chevaux lourds. Autrefois instrument de travail des agriculteurs, des ouvriers et des entreprises de transport, les chevaux lourds sont devenus en majorité des animaux de boucherie. Rappelons qu’instaurée dans la deuxième moitié du XIXe siècle à la fois comme moyen d’amélioration de l’alimentation humaine (I. Geoffroy Saint-Hilaire) et comme instrument de protection du cheval contre les mauvais traitements (É. Decroix et SPA), l’hippophagie a été organisée en filière dans les années 1970 par les Haras nationaux, alors dirigés par Henry Blanc, pour sauvegarder les neuf races de trait françaises. Même si des reprises d’utilisations traditionnelles des chevaux de trait voient aujourd’hui le jour, elles restent marginales.
3 - L’utilisation des chevaux de selle. Autrefois aristocrates et/ou militaires, hommes en tout cas, les « nouveaux cavaliers » sont en fait des cavalières (à 80 %), des jeunes et des membres des classes moyennes. Cette mutation est liée à la « massification » (et non à la « démocratisation ») de l’équitation, elle-même consécutive à l’essor du poney et du tourisme équestre dans les années 1960 et 1970. Cette évolution sociologique a entraîné une évolution culturelle : de la culture équestre de ?l’« homme de cheval » issue du XIXe siècle, fondée sur l’utilisation respectueuse du cheval (« qui veut aller loin ménage sa monture »), on est passé à une nouvelle culture équestre baroque fondée sur la diversification des pratiques équestres, souvent empruntées à des équitations ?« exotiques » : américaine, espagnole (doma vaquera), argentine (pato > horse-ball), etc, hédoniste délaissant l’effort technique et sportif au profit du plaisir et de la convivialité et sentimentale on ne respecte plus le cheval, on l’aime... Le cheval est devenu le troisième animal préféré des Français après le chat et le chien, tendance encouragée par toute une littérature à l’eau de rose, de mauvais petits romans d’amour de petites filles pour leurs poneys, qui inondent les librairies spécialisées... À l’occasion de la préparation de la loi française du ?6 janvier 1999 relative à la protection des animaux, la revue Cheval Magazine ?(n° 299 « spécial 25 ans », 1996, p. 55-57) a d’ailleurs explicitement réclamé que le cheval soit, au même titre que le chat et le chien, légalement reconnu comme ?« animal de compagnie ». La même revue et d’autres organes de presse ont fait ou font encore régulièrement campagne contre l’hippophagie, contre la caudectomie, contre le marquage au fer, contre le barrage des chevaux d’obstacle, contre le danger (pour les chevaux) des obstacles fixes (on se souvient que des associations américaines avaient tenté de faire annuler le complet aux JO d’Atlanta en 1996), contre certaines épreuves d’endurance, contre la « claustration » en box qui serait source de troubles comportementaux, contre la monte en mains assimilée à un « viol de la jument » j’en passe et des meilleures !
À cet égard, un fossé se creuse chaque jour davantage entre les professionnels du cheval, qui attendent de leurs animaux des performances et des revenus, et la masse des usagers du cheval dont la pratique ordinaire tend plutôt vers la sous-utilisation voire la non-utilisation de l’animal.
2. Plusieurs pratiques symptomatiques d’un nouveau type de rapport au cheval gagnent du terrain
1 - Le « cheval-potager ». Il s’agit d’un cheval que l’on garde chez soi, dans un coin de garage ou de jardin (d’où son nom). De ce fait, l’animal acquiert un statut familial : il est le centre des loisirs de toute la famille. Son alimentation (souvent trop riche) et son entretien (inadapté) deviennent l’affaire de tous et absorbent l’essentiel de leur temps libre. Dans la plupart des cas, le « cheval-potager » reste et c’est même là une de ses caractéristiques principales peu utilisé, ou voué à des activités comme la randonnée, qui privilégient l’intimité avec l’animal beaucoup plus que la technique équestre ou la performance sportive. Ce type d’hébergement et de pratique du cheval domine évidemment dans le Midi, qui bénéficie de conditions climatiques favorables (les élevages de loisir de la périphérie des villes sont en majorité des élevages équins).
2 - Le « horse-toy ». On connaît l’existence des falabellas et autres “horse-toys” de 45 cm au garrot. Importés d’outre-Atlantique, ils restent peu nombreux en France mais connaissent un succès grandissant, comme en témoigne leur prix qui a été multiplié par quatre ou cinq en moins de dix ans. Ceux présentés en 2003 au Salon de l’agriculture de Paris étaient vendus entre 1 800 et 3 000 € (12 000 et 20 000 francs) pièce et explicitement affichés comme « chevaux de compagnie », au grand dam des éleveurs de traits lourds des stands voisins qui militaient, eux, pour que le cheval conserve son statut de produit agricole. Déjà, pour les « chevaux d’appartement », une société australienne a mis sur le marché en 1999 les « couches pour chevaux ». Et l’on a déjà pu voir, au bois de Vincennes, des falabellas être promenés, non point en licol et longe, mais en collier et laisse !
Le paradoxe de cette situation est que le risque majeur de maltraitance des chevaux se situe aujourd’hui chez ceux qui prétendent les « aimer » le plus, et qui, croyant « bien faire » ou, en tout cas, ne pas mal faire, prennent chez eux de ces « chevaux potagers » ou « d’appartement » ou encore des chevaux « à la retraite ». Désormais coupés de la culture traditionnelle de l’« homme de cheval », ces « nouveaux propriétaires » n’ont souvent pas la moindre idée de la manière de nourrir et de soigner leurs protégés. Malgré eux, ils se rendent coupables de maltraitance par ignorance. Car, à cet égard, il en va des chevaux comme des autres animaux : plus ou les « aime », moins on les connaît; et moins on les connaît, moins bien on les traite.
3 - L’équitation auto-proclamée « éthologique ». Outre quelques avancées réelles (notamment en matière de débourrage), son succès s’explique par une habile association de plusieurs ingrédients au goût du jour. En premier lieu, l’étiquette d’« éthologie », totalement abusive : ou bien toutes les équitations sont nécessairement « éthologiques » (au sens commun), ou bien celle-là ne l’est pas plus que les autres ! De cette première illusion, on glisse tout naturellement, en second lieu, vers la supercherie qui consiste à faire croire au chaland, par une subtile mise en scène de la non-violence, que les méthodes des « chuchoteurs » et autres « nouveaux maîtres » méthodes prétendues « naturelles » ou inspirées d’un pseudo-idéal amérindien d’harmonie entre l’homme et ses « frères animaux » seraient fondées sur l’absence de domination du cheval ou sur sa persuasion afin de l’amener à consentir à sa propre domination. Le tout se traduit, en troisième lieu, par une flagrante sous-utilisation du cheval, la plupart des « prouesses » des « chuchoteurs » consistant en manipulations de l’animal à pied manipulations qui s’apparentent davantage aux concours d’« agility » canins qu’aux sports équestres, contribuant ainsi au processus sournois de canisation dont le cheval est actuellement l’objet.
Loin d’être anodines, ces attitudes et ces pratiques nouvelles font peser sur l’avenir des activités équestres et même de l’espèce chevaline un risque redoutable. En effet, le surinvestissement affectif et le protectionnisme dont le cheval est actuellement l’objet vont de pair avec une idéologie de non-utilisation de l’animal. Déjà, dans les faits, le cheval de selle n’est plus perçu que secondairement en tant que monture; des enquêtes menées dans des centres équestres et divers sondages indiquent qu’un nombre significatif de cavaliers de base se montrent, au fond, plus intéressés par la fréquentation des chevaux que par la pratique de l’équitation elle-même; on observe par ailleurs qu’un nombre croissant d’amateurs femmes pour la plupart, ce qui n’est sans doute pas un hasard acquièrent des chevaux à seule fin de... ne pas les utiliser. Loin d’être exceptionnelle, cette évolution correspond à l’un des aspects constitutifs du phénomène « animaux de compagnie » : pour accéder pleinement à leur statut d’intimes de l’homme, ces animaux doivent être entièrement disponibles pour leur maître, ne servir à rien d’autre qu’à sa compagnie. En Europe, le chien à partir de la Renaissance, le chat à partir du XVIIIe siècle, ont suivi cette trajectoire. Depuis les années 1950, le cheval s’est engagé à son tour dans une semblable évolution : jamais il n’a été aussi bien traité ni autant aimé que depuis qu’il ne « sert » plus à la guerre, aux champs ou sur les routes.
Bref, le statut actuel du cheval tend vers celui de l’animal de compagnie. ?Y parviendra-t-il un jour ? Il y a tout lieu d’en douter, ne serait-ce qu’à cause de sa taille (exception faite du falabella) et de son incapacité à contrôler ses sphincters. Or l’histoire nous apprend que tout animal qui, ayant quitté le groupe des animaux de rente, ne réussit pas à se faire admettre dans celui des animaux de compagnie, est condamné à ne plus constituer qu’une nuisance comme les mustangs aux États-Unis ou les brumbies en Australie. Autrement dit, si les sensibilités animalitaires contemporaines s’inscrivent dans la longue durée, l’espèce chevaline qui, il faut s’en souvenir, ne subsiste plus aujourd’hui qu’à l’état domestique risque fort de se trouver menacée dans un avenir plus ou moins lointain. À ceux qui jugeraient cette perspective exagérément alarmiste, on se contentera de rappeler que les races de chevaux lourds sont d’ores et déjà menacées d’extinction par la lame de fond anti-hippophagique, en l’absence de débouchés de substitution suffisamment consistants.
Comme la langue d’Ésope, l’« amour » du cheval contient à la fois le meilleur et le pire. Sans aucun doute, c’est lui qui a servi de moteur au spectaculaire essor des sports et des loisirs équestres depuis une trentaine d’années, ainsi, par voie de conséquence, qu’au maintien de l’élevage équin. Mais, sous la poussée du mouvement animalitaire et de l’idéologie de non-utilisation de l’animal que celui-ci véhicule, cet engouement peut aussi, si l’on n’y prend pas garde, conduire à l’évolution inverse. Alors que la plupart des disciplines sportives ont progressé du jeu au sport, l’équitation paraît déjà, à bien des égards, en train d’effectuer le trajet en sens contraire : des sports équestres vers des activités, à dominante ludique et sentimentale, de simple manipulation des chevaux. Source d’embellie numérique, la popularité et la massification du cheval peuvent conduire à sa banalisation et à une dégradation qualitative de ses usages, à une décadence, à une récession et enfin à une quasi-disparition des activités équestres.
III. Que faire ?
En résumé, quatre catégories de personnes ayant chacune leurs pratiques et leurs discours propres se trouvent aujourd’hui en présence :
1 - des professionnels du cheval, héritiers et dépositaires d’une culture équestre ancienne, agricole ou sportive, mais qui sont devenus minoritaires;
2 - une majorité de citadins, possesseurs ou non d’animaux de compagnie, mais qui ont tendance à voir tous les animaux, y compris les chevaux, sous les traits de leurs animaux familiers;
3 - une minorité infime mais très active de militants animalitaires qui propagent, auprès d’un public mal informé, une vision péjorative de l’élevage et de l’utilisation des animaux;
4 - une population croissante de « nouveaux cavaliers » et de « nouveaux éleveurs », pour la plupart issus de la catégorie (2), qui sont le vecteur inconscient ou involontaire de l’introduction dans la catégorie (1) de sensibilités et d’attitudes de la catégorie (3).
Les actions à mener doivent donc viser à :
1. soutenir les éleveurs professionnels;
2. informer le grand public;
3. combattre les animalitaires;
4. former les néo-éleveurs.
Dans la pratique, les quatre niveaux se confondent ou se recoupent plus ou moins. Reprenons-les un par un en commençant par celui dont l’urgence apparaît la plus grande.
1. Combattre l’activisme animalitaire
L’activisme animalitaire s’est pour l’instant peu attaqué directement à la filière Cheval. Les secteurs visés ont surtout été le transport des chevaux déjà réglementé outre-mesure, de sorte que l’on voit mal ce qui pourrait être encore être ajouté, sauf à l’interdire complètement ! et la boucherie chevaline voir les campagnes calomnieuses de la Fondation Brigitte Bardot (jusque dans un supplément « Équitation, nouvelle passion française » au journal Le Monde du 8 mai 20087, p. VII, sous le titre « Le cheval, vous l’aimez comment : en ami ou en rôti ? »).
Pour le reste, on peut sans doute trouver, ici ou là, des équidés en situation de maltraitance. Mais il s’agit presque toujours de cas isolés, de sorte que, dans l’ensemble je ne crains pas de le dire, dans la France de ce début du XXIe siècle, les équidés maltraités ou à l’abandon sont proportionnellement moins nombreux que les humains en grande détresse économique et psychologique, les chevaux martyrs plus rares que les femmes et les enfants battus ou abusés, et les conditions de transport des chevaux meilleures que celles des Parisiens sur la ligne 13 du métro aux heures de pointe.
Le problème principal, dans ce domaine, réside moins dans le mal-être animal lui-même que dans les dimensions irrationnelles et affectives qui donnent à cette notion une résonance particulière dès lors qu’elle s’applique au cheval, espèce à forte valeur affective et symbolique. Ainsi, par exemple, on peut rappeler que la généralisation du logement des chevaux en box, que certains assimilent aujourd’hui à de la ?« claustration », a été dictée par des considérations anthropomorphistes tout autant que de commodité. En réalité, la plupart des chevaux se montrent plus calmes à l’attache tête au mur en stalles qu’en liberté dans 9 m2. Ce ne sont donc pas les chevaux que l’attache dérange, mais les hommes !
D’autres dangers potentiels existent, dont la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie (adoptée le 13 novembre 1987, ratifiée par la France le 8 juillet 2003 et dont le décret d’application date du 28 août 2008) offre un bon exemple. Son article 1 donne la définition suivante : « On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme, notamment dans son foyer, pour son agrément et en tant que compagnon » (définition qui a été introduite sous une forme resserrée dans le Code rural, art. L214-6, J.O. du 21 septembre 2000 : « On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme pour son agrément »). Traitant du dressage, l’article 7 stipule que « Aucun animal de compagnie ne doit être dressé d’une façon qui porte préjudice à sa santé et à son bien-être, notamment en le forçant à dépasser ses capacités ou sa force naturelles ou en utilisant des moyens artificiels qui provoquent des blessures ou d’inutiles douleurs, souffrances ou angoisses ». Outre qu’elles portent atteinte au caractère positif du droit français – quel juge sera en mesure de statuer sur des notions aussi discutables que les « force naturelle » d’un animal ou le caractère « artificiel » de moyens de dressage ?, ces définitions et ces dispositions peuvent fort bien concerner le cheval et s’appliquer au mors, aux enrênements, aux éperons. Qui peut dire, au train où vont les choses, qu’ils ne seront pas un jour interdits, comme serait interdite toute utilisation du cheval autre que celle d’animal de compagnie, idéal bardotien du dada-à-sa-mémère.
La riposte doit être à la hauteur de la réalité de la menace animalitaire. Commençons par quelques exemples de ce qu’il ne faut surtout pas faire :
1 - Ne rien faire, pratiquer la politique de l’autruche, rentrer la tête dans les épaules et se boucher les oreilles en espérant que le boulet passera à côté et ira tomber sur le voisin : on ne méditera jamais assez la terrible leçon de l’interdiction de la chasse à courre en Grande-Bretagne !
2 - En faire trop, devancer les critiques dans l’espoir de calmer le jeu. C’est ce qu’ont cru pouvoir faire, en limitant le nombre de coups de cravache à trois successifs, la FFE dans le Règlement général des compétitions en 1990 et France Galop dans le Code des courses au galop en 2005. La mise au pilori de ce geste technique élémentaire qu’est le coup de cravache n’a fait en réalité que donner des gages aux animalitaires et que créer un précédent dont ils ne manqueront pas de tirer argument pour en réclamer plus encore.
3 - Jouer au malin en s’engouffrant dans ce que l’on croit représenter un nouveau marché. C’est ainsi que la FFE, alléchée par la mode des chuchoteurs, s’empressa de créer des diplômes d’équitation éthologique.De même, face à la féminisation, elle en fait toujours plus pour les filles, et quand enfin elle se demande « Qu’offrir d’attractif aux garçons ? » (REF de janvier 2007), ce sont tous les clichés sexistes les plus éculés qu’elle étale : frilosité des filles, combativité des garçons, etc. Les Haras nationaux ne se montrent guère plus brillants quand, croyant tirer les enseignements d’un sondage de 2006 commandité par eux et la FIVAL (Fédération interprofessionnelle du cheval de sport et de loisir) qui montrait que les Français s’intéressent plus au spectacle et à la fréquentation des chevaux qu’à l’équitation proprement dite (ce que les sociologues savaient déjà depuis longtemps !), les Haras ont développé une campagne de « communication » sur le thème : « si l’on veut exploiter ce marché, il faut s’inscrire dans la stratégie de consommation porteuse du moment ». C’est-à-dire ? Produire du cheval de compagnie ?
4 - Camper sur des positions uniquement défensives en tentant de répondre point par point aux accusations des animalitaires, et se laisser ainsi entraîner sur leur terrain. Telle fut, faute de préparation, l’expérience amère des « Rencontres Animal et Société » du printemps dernier au ministère de l’Agriculture où je siègeais en tant que scientifique, avec Jean-Luc Poulain qui représentait la FNSEA.
Au total, il n’existe aucune raison objective de se montrer complaisants envers les thèses animalitaires, qui n’ont déjà que trop gagné de terrain, compte tenu de leur caractère très minoritaire. Il y a au contraire toutes les raisons de les ignorer ou de s’y opposer, en vertu d’un principe de réalité simple qui est celui-ci : ce qui ne va pas dans le sens de l’intérêt de l’homme n’a aucune chance d’être adopté et de s’inscrire dans la durée. La seule manière réaliste d’envisager la question de nos rapports aux animaux consiste donc à se poser les questions suivantes : qu’est-ce que les hommes (en y incluant nos descendants pour une perspective durable) ont intérêt à faire ou à ne pas faire aux animaux ? Si les animaux peuvent trouver avantage à un meilleur traitement, quel intérêt la bien-traitance animale représente-t-elle pour l’homme ? Sur le plan matériel, permet-elle une optimisation de l’utilisation des animaux, ou bien contribue-t-elle au contraire à la limiter ? Dans cette dernière hypothèse, jusqu’où l’homme est-il prêt à restreindre ses attentes au profit de la bien-traitance des animaux ?
À moins d’une improbable révolution dans les techniques d’élevage, on imagine mal des systèmes futurs qui réussiraient à n’imposer aucune contrainte aux animaux; c’est donc dans les domaines (comme le transport des animaux vivants) où l’intérêt des exploitants rejoint celui des animaux que les améliorations les plus sensibles ont été et peuvent encore être obtenues.
2. Il est plus motivant et donc plus efficace de se battre pour quelque chose que contre quelque chose
Il faut donc privilégier les actions constructives :
1 - soutenir les éleveurs agriculteurs et néo-ruraux, notamment en leur proposant des compléments de formation technique (gestion des prairies, alimentation...) et économique (gestion, débouchés, commercialisation...)
2 - informer le public par des campagnes d’explication et de sensibilisation sur les métiers et les produits de l’élevage
Loin de moi la prétention de vous dire ce dont vous avez besoin dans ces domaines. Permettez-moi simplement d’insister, pour terminer, sur quelques grandes orientations générales :
1 - La situation des éleveurs est déjà difficile, leur métier particulièrement contraignant, leur niveau de vie en baisse. Il est ignoble, en plus, de les culpabiliser en faisant peser sur eux le soupçon de maltraiter leurs animaux.
Sans parler des couvertures insultantes de publications mettant en parallèle élevages industriels et camps d’extermination nazis (cf. Florence Burgat, Les animaux d’élevage ont-ils droit au bien-être ?, INRA, 2001), je garde un souvenir particulièrement pénible de l’interview, sur un ring de présentation au Salon de l’agriculture 2008 à Paris, d’un éleveur de splendides chevaux lourds : cet homme était visiblement paralysé par la peur de devoir expliquer qu’il élevait des chevaux pour la boucherie !
Face aux campagnes ignobles et insultantes contre la filière Viande, il faut soutenir les professionnels et les aider à effectuer au mieux leur métier : le stress des animaux dans certaines conditions d’élevage est peu de chose à côté du stress des éleveurs croulant sous des contraintes en tous genres de plus en plus lourdes. Et comme le reconnaît lui-même un des plus ardents avocats de la recherche sur le « bien-être animal » : « une insistance trop exclusive sur le bien-être animal risque de compromettre le bien-être de l’éleveur » (Robert Dantzer).
2 - La dénonciation des mensonges et des excès des uns, les animalitaires, ne doit pas faire oublier les carences de quelques autres. Aucun éleveur n’a intérêt à maltraiter des animaux ni à leur imposer des conditions d’élevage ou de sélection (hypertypes) contraires à leur bien-traitance à long terme et à la survie même de certains élevages à moyen terme : cela comporte des risques pour la santé animale comme pour la santé humaine, y compris psychique, c’est un signe d’incompétence et de manque de professionnalisme, et c’est économiquement improductif.
3 - Dans le domaine de l’action à court et à moyen terme, il faut privilégier les mesures incitatives et l’information plutôt que les règlements, lois et mesures répressives que réclament les associations animalitaires (souvent pour des motifs qui sont loin d’être désintéressés) règlements, lois et interdictions dont l’empilement conduit à une jungle juridique de plus en plus impénétrable.
Cette information doit cibler principalement le grand public pour lui faire comprendre que le statut d’animal de compagnie le seul qu’il connaisse, dans lequel certains voudraient entraîner le cheval, est un statut très particulier, qui ne saurait être étendu à tous les animaux, et un statut qui n’est pas toujours aussi enviable qu’il le croit : traiter un animal pour ce qu’il n’est pas (en l’anthropomorphisant ou en voyant en lui un substitut d’enfant) est une forme de maltraitance et un facteur de troubles du comportement de plus en plus fréquents d’où l’éclosion, relativement récente, de la spécialité de « vétérinaire comportementaliste ».
4 - On a vu que les instances dirigeantes de certains organismes scientifiques ou de certaines filières animales se laissent bluffer par les discours animalitaires au point de fonder sur eux des programmes de recherche ou des stratégies marketing.
Osons une comparaison : imaginons que, constatant le gouffre qui sépare la culture des professeurs de lettres et celle des élèves des ZEP, le ministère de l’Éducation nationale décide d’enseigner désormais le « neuf-trois » au lieu du français dans les lycées et les collèges, et de remplacer Molière et Hugo par Doc Gynéco et NTM dans les programmes du secondaire. Ce serait évidemment absurde. C’est pourtant ni plus ni moins ce que les Haras nationaux suggèrent de faire : puisque le modèle animal dominant dans la société occidentale est celui de l’animal de compagnie, il faudrait transformer les animaux de rente en animaux dont la production et l’utilisation (si tant est qu’il soit encore possible ?d’« utiliser » de tels animaux) ne serait plus régie que par les exigences de leur ?« bien-être » ou, plus exactement, de la représentation que les hommes s’en font.
Il faut absolument rompre avec ce suivisme démagogique : toujours tout aligner sur les attentes du plus grand nombre, surtout dans des domaines techniques très spécialisés comme les productions animales, revient à tirer tout et tout le monde vers le bas.
Conclusion
Les organismes publics (Haras et autres) et les organisations professionnelles représentatives ont une responsabilité particulière. Ils doivent laisser la « communication » à d’autres et remplir sans concessions une mission d’information des professionnels et du public. « Communiquer » (au sens actuel), c’est dire au public ce qu’il a envie d’entendre, pour le séduire à des fins diverses (électorales, clientélistes ou d’audience). L’informer, c’est lui dire la vérité. Et la vérité, pour ce qui concerne notre propos, c’est :
1 - que les chevaux, aujourd’hui en Europe occidentale, manquent moins de « bien-être » que de débouchés économiquement rentables et durables;
2 - que les débouchés, pour les chevaux, ce sont des utilisations;
3 - qu’il ne saurait y avoir d’utilisations des animaux sans fortes contraintes pour ceux-ci, ainsi, d’ailleurs, que pour les hommes qui les produisent et les utilisent mais ce n’est pas à vous que je vais l’apprendre.
Tout le reste n’est que littérature à l’eau de rose.
Jean-Pierre Digard
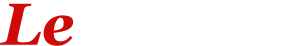
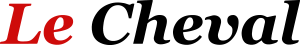
 Open Amateur
Open Amateur Culture
Culture Filière
Filière Juridique
Juridique





























Vous devez être membre pour ajouter des commentaires. Devenez membre ou connectez-vous